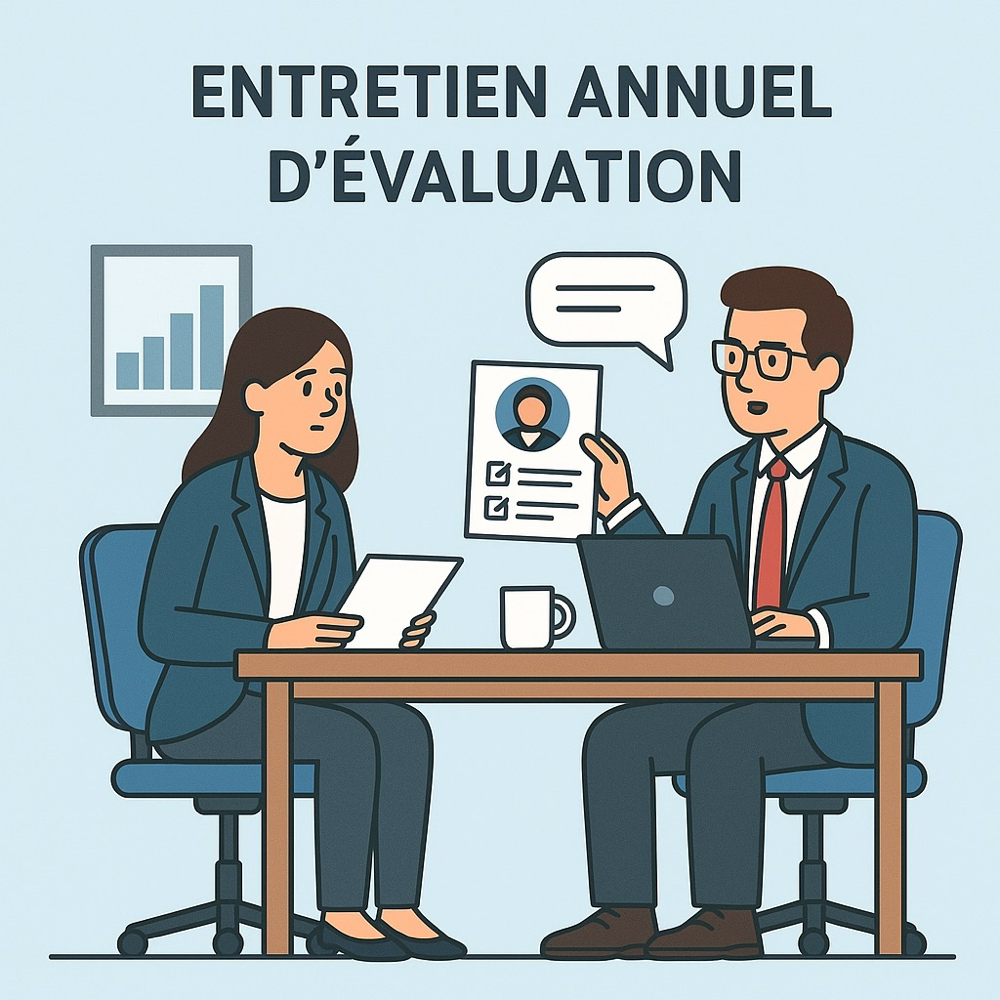Chaque année, il revient. Comme la grippe saisonnière ou les réunions du lundi matin : l’entretien annuel d’évaluation.
Dès novembre, les premiers frissons apparaissent dans les couloirs :
“Tu l’as eu, toi ?”
“Il a duré 11 minutes, record battu !”
“J’ai eu 3,7 en ‘proactivité’… je crois que c’est bien.”
Le salarié s’y prépare comme à une épreuve du bac.
Il révise ses livrables, relit les fiches projet, cherche désespérément ce qu’il a bien pu faire au mois de mars.
Puis il remplit le formulaire RH : 12 pages à cocher, commenter, nuancer, lisser.
La case “sait travailler en transversalité” reste toujours mystérieuse.
De son côté, le manager s’y colle à contre-cœur, entre deux réunions et une crise Excel.
Il relit distraitement le document de son collaborateur, survole les réussites, multiplie les formulations molles :
“Peut encore gagner en impact.”
“A su prendre sa place dans l’équipe.”
“Montre une belle capacité d’évolution, sous réserve.”
Vient alors le moment solennel : le rendez-vous.
30 minutes de diplomatie molle, dans un bureau trop chauffé.
On y parle de “montée en compétence”,
de “positionnement dans la matrice”,
de “dynamique collective”,
et de “points de vigilance” (traduction : ce qui agace vraiment mais qu’on n’ose pas dire).
Le collaborateur tente un coup : “Je vise une augmentation.”
Le manager lève un sourcil : “Ce n’est pas le sujet de l’entretien.”
À la fin, tout le monde signe.
Avec soulagement.
Le document est transmis à la RH, puis classé.
On n’en parlera plus jamais. Jusqu’à l’année prochaine.
Et tout le monde repart, avec une note de 3,8 sur 5,
des objectifs flous,